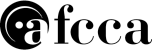A lire : Disparition Alain Delon : du «Guépard» au «Samouraï», les légendes meurent aussi

"On avait fini par le croire immortel. Il nous avait pourtant prévenus : «Un héros doit toujours savoir mourir.» Et lui, à l’évidence, il savait. A 14 ans, déjà, petite gouape élégante dans un court métrage amateur, le Rapt (1949), réalisé par le père d’un copain avec une caméra Super 8, il s’effondrait, fauché par une balle, la main sur le cœur. Raflé, supplicié et martyr. D’instinct, il connaissait les gestes. Etait-il déjà mort ? En tout cas, il en avait le don. Visage juvénile et offert d’une pâleur si gracile que les bords vaporeux du cadre, tout frémissants de blancheur, semblaient s’en émouvoir. Le film ne dure que quelques secondes, juste le temps de le voir mourir. A peine apparu déjà disparu. Un éclair aimanté par les ombres mais promis à la lumière. Tout Delon y fulgurait déjà : les ténèbres et la grâce, la science innée du mouvement et une présence si dévorante qu’elle en éclipse tout le reste.
Jusqu’à l’annonce de sa mort, à 88 ans, ce dimanche 18 août par ses trois enfants auprès de l’AFP. «Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que [son chien] Loubo, ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de leur père. Il s’est éteint sereinement dans sa maison de Douchy, entouré de ses trois enfants et des siens. […] Sa famille vous prie de bien vouloir respecter son intimité, dans ce moment de deuil extrêmement douloureux», déclare leur communiqué.
Ce tout premier échange avec la caméra, dont il n’avait jamais spécialement désiré la rencontre, laissant ses pas et sa turbulente jeunesse le porter ailleurs en se débrouillant pour que le temps passe, allait augurer tant et tant d’autres morts, une fois le cinéma venu à lui «par accident». De mémoire, 27. Faut-il les énumérer toutes ? Laissons-les nous assaillir en flashs : flingué gants blancs sur la poitrine dans le Samouraï, caressant un chat dans Scorpio, guillotiné dans Deux hommes dans la ville, pendu dans la Tulipe noire, poignardé dans Traitement de choc, terrassé par une crise cardiaque dans l’Homme pressé, crucifié d’une rafale dans la Veuve Couderc et le Cercle rouge, abattu sur les remparts de Fort Boyard dans les Aventuriers ou sur un terrain vague dans le Clan des Siciliens, à bout portant devant la télé dans Attention, les enfants regardent, trahi au moment où il s’y attendait le moins dans les Grands Fusils, rattrapé par son double dans «William Wilson» (1) ou se fermant lui-même les yeux dans l’Insoumis – un geste d’une puissance iconique telle que les Smiths en utiliseront l’image pour la pochette de leur album The Queen is Dead en 1986.

Beauté fulgurante et magnétisme affolant
Voilà donc l’évidence : Alain Delon n’est pas mort, il n’a jamais cessé de mourir. Comme si la répétition de ces derniers instants avait été la part dévolue au tragique d’un acteur dont la beauté foudroyante semblait n’avoir concédé de s’offrir à notre regard que pour mettre en scène sa propre disparition. La tentation du vide semble parrainer l’histoire de ses rôles, du Samouraï (1967) de Melville au Professeur (1972) de Zurlini, de Rocco et ses frères (1961) de Visconti à Monsieur Klein (1976) de Losey, déclinant un chapelet de figures fantomatiques, de cadavres en sursis, d’icônes sacrifiées et d’identités évanouissantes, qui semblent appeler l’issue fatale qui les attend. Et si Delon n’avait jamais été aussi grand que lorsqu’il s’effaçait pour tendre vers sa propre perte ?
Depuis quand avait-il fait de la grande faucheuse une compagne dont il disait ne pas craindre la venue, prêt à devancer le rendez-vous, si la vie devenait insupportable ? Et ces vers de Victor Hugo, «je suis seul, je suis veuf, et sur moi le soir tombe», quand les avait-il faits siens ? Un indice : la Chambre verte était un de ses films préférés – un entretien donné aux Cahiers du cinéma en 1996 nous l’apprend. Si l’on s’en tenait à la caricature qui précède le personnage (le goût pour les flingues et les fréquentations douteuses, les positions virilistes et droitières, un monde régi par le code d’honneur et la parole donnée), on s’en étonnerait presque : rien a priori ne semble plus éloigné de l’univers de Delon que le cinéma de François Truffaut. Du reste, la Nouvelle Vague ne l’avait-elle pas soigneusement évité, ne sachant que faire de ce diamant brut trop instinctif, trop grave, pas assez histrion et décalé dans son jeu – d’ailleurs jouait-il seulement ? Mais ce film-là, où Truffaut, voix blanche, teint cireux, tenait lui-même le premier rôle, ce rescapé de 14-18 vivant dans le culte de son épouse défunte, Delon ne pouvait que s’y reconnaître. «Beaucoup de ceux que j’ai aimés ne sont plus, je suis entouré de morts», disait-il à la fin de sa vie, aux heures de grande mélancolie. Dans sa propriété de Douchy (Loiret), un mausolée protégé de la lumière du jour entretenait, paraît-il, le souvenir de ses chers disparus, photos et reliques pieusement conservées.
D’abord les femmes aimées : Romy (Schneider), Mimi (Mireille Darc), Mounette (sa mère). Et puis ses «maîtres», ceux à qui il devait d’être ce qu’il était devenu, et auxquels, ému, il ne cessera jamais de rendre hommage : René Clément, «le plus grand directeur d’acteurs» selon lui, figure paternelle qui, avec Plein Soleil, avait offert à sa présence trouble une plus vive lumière. Luchino Visconti, «un esthète, un seigneur de la Renaissance», qui saura déceler chez le gamin des faubourgs l’élégance d’un prince, et Jean-Pierre Melville «un auteur, un artiste complet» avec lequel il partage les mêmes valeurs masculines, l’amour du milieu et le sens du tragique. Et puis Losey, Gabin et les autres… Et de tous les défunts dont il portait le deuil, le plus précieux d’entre tous, peut-être : le cinéma, son cinéma. Mort lui aussi. Ironie du sort, les derniers feux de sa filmographie – que l’on situe à la louche à l’orée des années 90, avec Nouvelle Vague de Godard, la suite se délitant en une flopée de navets plus ou moins retentissants – s’éteignent précisément au moment où, dans un sépulcral rituel d’embaumement, la cinéphilie prophétisait du septième art le trépas. Godard aurait-il tué l’acteur Delon ? Allez savoir.
Son jeu semblait tirer sa force de sa seule présence – être là, évoluer dans l’espace et rien d’autre, ne jamais «composer», car rien n’est plus étranger à Delon que l’idée de performance, sa séduction suscitant l’adhésion immédiate, ou inversement.
Quoi qu’il en soit, l’issue de cette carrière exceptionnelle ne laisse planer aucun doute : le mystère Delon – sa beauté fulgurante, puisqu’il faut bien appeler les choses par leur nom, ce magnétisme affolant les boussoles, provoquant stupeur et tremblements à chacune de ses apparitions – a à voir avec l’essence même du cinéma, qu’il soit d’auteurs (Visconti, Losey, Clément, Zurlini, Antonioni) ou populaire (Tessari, Verneuil, Deray, Giovanni, Lautner). Est-ce parce que son jeu semblait tirer sa force de sa seule présence – être là, évoluer dans l’espace et rien d’autre, ne jamais «composer», car rien n’est plus étranger à Delon que l’idée de performance, sa séduction suscitant l’adhésion immédiate, ou inversement (mais rarement) le rejet épidermique ? La trajectoire d’acteur semble faire indistinctement corps avec la vie de l’homme.
Sa vie, elle s’est achevée à Douchy, dans ce château de la Brûlerie qui avait connu le chaos des seventies, la présence apaisante de Mireille Darc, les amis boxeurs dont il aimait organiser les combats, d’autres moins recommandables qui lui avaient valu d’être inquiété par la justice en 1968 avec l’affaire Markovic (son garde du corps retrouvé assassiné dans une décharge) avant d’en faire la forteresse de ses vieux jours, dont il aimait arpenter l’immense parc, entouré d’une nuée de chiens. Il avait même fait élever une chapelle pour y être enterré à quelques mètres du cimetière canin où reposent les 50 molosses qui ont partagé sa vie.
Mais le domaine était un gouffre et il rejoignait souvent le confort moins lugubre d’un bel appartement genevois. Peut-être l’isolement était-il devenu trop lourd à porter, même pour lui, le loup solitaire ? Peut-être les hauts murs ceignant sa propriété avaient-ils fini par lui rappeler un peu trop ceux de la prison de Fresnes, où, petit enfant placé dans une famille d’accueil dont le père était maton, il avait grandi avec pour seuls compagnons de jeu les mômes des autres gardiens et pour tout décor les quartiers disciplinaires et la cour où il voyait les détenus faire leur promenade quotidienne…
Car c’est loin, très loin, qu’il faut remonter pour mettre à fleur de terre les racines d’une solitude qui ne l’a jamais quitté et qui sera la matrice de son «jeu», nimbant son iris couleur de mer agitée d’un léger voile de givre et grêlant sa présence d’une opacité si inquiétante qu’elle pouvait sauver du naufrage le plus anecdotique des polars ou magnifier les œuvres de ses grands maîtres qui, elles, n’avaient pas besoin d’être sauvées.
CAP de charcuterie et passion pour le cyclisme
«Il porte sur le monde ce regard d’acier où tout au fond, on voit briller les larmes de la petite enfance», écrivait son ami Pascal Jardin. Il faut donc revenir aux premiers pas d’un gamin du divorce, ballotté d’un foyer à l’autre, abandonné et mal aimé. Né à Sceaux, au sud de Paris, le 8 novembre 1935, il a 4 ans quand la guerre éclate, mais son apocalypse à lui, c’est la séparation de ses parents, cette même année. Sa mère, Edith, dont il a hérité de la beauté, et son père, Fabien, directeur d’un cinéma de Bourg-la-Reine refont leur vie chacun de leur côté. Alain, le fils chéri (si gracieux que «Mounette» avait dû accrocher une pancarte sur sa poussette disant «Regardez moi mais ne me touchez pas !») était à présent devenu encombrant. Alors on le place en nourrice à Fresnes, et quelques années plus tard en pension. Une bonne dizaine d’établissements dont il se fait renvoyer régulièrement. On le dit ingérable, il est consigné le week-end et reste parfois des mois sans pouvoir revoir les siens. Un enfant terrible, mais terriblement malheureux. Alors il serre les dents et se tanne le cuir. Solitaire et mutique. Melville saura s’en souvenir.

Sa mère remariée à un charcutier le récupère. Delon envisagera-t-il sérieusement de reprendre la suite du commerce, qui tourne bien ? Toujours est-il qu’il passe son CAP de charcuterie et se passionne pour le cyclisme. Mais son regard ravageur, mariant une violence rentrée à des éclats de candeur, voit déjà plus loin. Il devance l’appel sous les drapeaux puis s’engage pour l’Indochine à 17 ans. Ses parents le laissent partir. A la guerre. Plus tard, il en concevra un sentiment d’abandon, une blessure qui ne se refermera jamais. A Saigon, la mort, toujours elle, est partout palpable, lors des patrouilles sur le fleuve, dans l’ombre de l’ennemi invisible, les dents qui claquent de peur dans la nuit… Delon l’insoumis enchaîne les conneries, pique du matériel radio, emprunte une Jeep pour faire la fête. Il passera plus de temps au trou qu’en manœuvres. Et au bout de quatre ans, il est RDSF, «renvoyé dans ses foyers». L’armée pourtant, aura été son école, sa seule vraie famille.
«Comédien c’est une vocation, avec des années d’apprentissage ; acteur, c’est un accident. Je suis un accident.» — Alain Delon
1956. Que faire à Paris, quand on a 21 ans, une gueule d’ange frondeur et la beauté du diable ? Rien. Traîner à Pigalle ou à Saint-Germain-des-Prés, passer alternativement du milieu des petits voyous et des filles de rue à celui des apprentis comédiens et des vedettes en vue, mais ne rien prévoir. Laisser venir. D’abord une actrice de dix ans son aînée, Brigitte Auber, remarquée dans la Main au collet de Hitchcock, lui tombe dans les bras. Puis une autre, Michèle Cordoue, qui lui présente son mari Yves Allégret. Le jeune homme, morgue canaille et léger accent faubourien, correspond pile poil à ce que le cinéaste recherche pour son prochain film Quand la femme s’en mêle (1957). Delon s’en fiche (on le comprend), mais il accepte. Le cinéma ou autre chose… Pourtant il suffira de quelques jours pour qu’il tombe littéralement amoureux de la caméra. Coup de foudre, il n’avait rien fait pour. Comme avant lui Gabin, qui venait du music-hall, Burt Lancaster du cirque ou Lino Ventura du catch, lui venait de l’armée et de la rue, il n’était pas comédien. «Comédien c’est une vocation, avec des années d’apprentissage ; acteur, c’est un accident. Je suis un accident», dira-t-il souvent. Il aurait pu enchaîner longtemps les bluettes inconsistantes du même acabit – parmi lesquelles Sois belle et tais-toi où, bien avant Borsalino, il donnait la réplique à son futur rival au box-office Jean-Paul Belmondo, ou encore Christine, avec la jeune Allemande Romy Schneider, starisée grâce à son rôle de Sissi. «Une petite bourgeoise», ironise-t-il, avant que l’amour ne s’invite sur le tournage pour une idylle qui durera cinq ans. Il aurait pu, oui, se dessécher dans le costume du jeune premier fringant. Mais quand René Clément lui propose le rôle de Greenleaf, le fils de famille désœuvré et noceur qui se fait assassiner au premier tiers de Plein Soleil (1960), Delon, avec un aplomb et un jugement très sûr, refuse catégoriquement. Celui qui l’intéresse, c’est l’autre, le sombre Tom Ripley, le meurtrier duplice qui usurpe l’identité de sa victime. Bras de fer avec la production jusqu’à ce que, du fond de la salle, une voix de femme à l’accent slave, Bella, l’épouse du réalisateur, tranche : «Rrrrené chérrri, le petit a rrrraison.»
Un regard confinant à l’hypnose
Ce coup de force génial va le propulser au sommet d’une carrière qui dès lors enchaîne les chefs-d’œuvre à une cadence ahurissante. Inaugural, Plein Soleil met en lumière la persona Delon : intuition animale, captation par le regard confinant à l’hypnose et domination de l’espace. Car c’est d’abord un corps en mouvement, imposant à la caméra de le suivre, que filme Clément, une silhouette féline brûlée par le soleil d’Italie qui, tel un prédateur s’appropriant un territoire, prend possession du cadre, en délimite les contours par ses déambulations, et que son impétuosité menace toujours de déborder – ce sera souvent le cas dans l’Eclipse (1962) d’Antonioni, où Delon, campant un courtier en Bourse, décadrait souvent, traversant le champ en tous sens. La façon dont Ripley tend sa toile en dit long sur la «méthode» Delon, cet art d’entrer dans un rôle – ou plutôt le contraire car, pour reprendre la formule de Jean-François Rauger dans un bel article des Cahiers du cinéma, cité dans l’Œil qui jouit (Yellow Now, 2012) : «Ce sont ses rôles qui le vivent.»
A regarder sur YouTube : la bande-annonce de Plein Soleil de René Clément
Et c’est en effet une contamination, une prédation mêlant rouerie et intuition : quadriller le terrain, faire siens les objets, la voix, l’écriture, les gestes, de façon immédiate quasi médiumnique. Une incorporation de l’autre, comme s’il en était possédé. Il faut voir la façon dont Clément capte la perversité narcissique et schizophrène de Ripley dans la fabuleuse séquence du miroir, où Delon, déguisé en Greenleaf, se mire en l’imitant, et finit par embrasser son propre reflet dans la glace. Scène primitive d’auto-érotisme qui fonctionne, à l’image du concept lacanien du stade du miroir, comme une identification : ce moment où le sujet prend conscience de lui-même à travers sa propre image. A ceci près qu’ici, elle fusionne avec celle d’un autre.
«Je» est un autre et cet autre est de trop
Ce rôle complexe posera les bases d’une filmographie qui sera souvent parrainée par le thème du double, du transfert de personnalité, volontaire ou non, de la perte d’identité, de la subjectivité troublée, déglinguée, vidée de sa substance. On ne compte plus le nombre de films où l’acteur se dédouble (Nouvelle Vague, la Tulipe noire de Christian-Jaque, «William Wilson» de Louis Malle dans Histoires extraordinaires), incarne une figure de la duplicité (Zorro de Duccio Tessari) ou prend la place d’un autre (Plein Soleil donc, Diaboliquement vôtre de Julien Duvivier et surtout Monsieur Klein de Joseph Losey). Monsieur Klein (1976) qui parachève la mutation aliénante, puisque d’une certaine façon, c’est l’autre qui cède sa place dans un processus moins kafkaïen que lovecraftien, proprement terrifiant. Et il fallait bien ce recours subreptice au fantastique pour dire la folie d’une époque telle que l’Occupation, obsédée par la notion de «pureté» (du sang et des origines). La quête délirante d’identité, semble nous dire le film, ne peut conduire qu’à sa dilution. Delon, producteur enthousiaste, portera le projet avec une énergie comparable à celle qu’il impulse à son personnage, c’est l’obsession – car il s’agit bien d’une pathologie – qui inexorablement l’attire vers cet autre (que) lui-même.
La recherche du double infusera jusqu’à sa vie amoureuse, âmes sœurs (Romy Schneider, Mireille Darc) ou passion gémellaire : Nathalie Delon (mère de son fils Anthony), la seule qu’il ait épousée, peut-être parce qu’elle lui ressemblait trait pour trait.
Les duels qui s’orchestrent dans la filmographie de Delon soulignent aussi le paradoxe de l’homme : être solaire et ombrageux, hypersensible et violent, acteur génial et star populaire, un genre de Clint Eastwood à la française, pouvant aussi bien incarner des êtres énigmatiques que des monolithes à la mâchoire serrée.
Quand l’acteur ne se dédouble pas à l’écran, d’autres, figures tutélaires, paternelles, fraternelles ou ennemies cristallisent la rivalité malade à laquelle le sujet Delon se doit de se mesurer pour pouvoir s’éprouver. En somme, dans l’univers delonien, «je» est un autre et cet autre est de trop. Même quand ce dernier prend les traits du très respecté prince Salina dans le Guépard (1963) qu’incarne Burt Lancaster, il demeure une menace, parce qu’il est un modèle, auprès duquel même un Tancrède aussi sublime soit-il, ne sera jamais qu’une copie. Deux séquences clés : au début du film, le prince Salina en train de se raser devant une petite glace de barbier reçoit la visite de Tancrède qui vient lui annoncer son ralliement aux troupes de Garibaldi. Soudain, le visage de Delon (sa toute première apparition dans le film) surgit dans le miroir à la place du reflet de son oncle. Que le nouveau monde qu’il incarne vienne accessoirement donner à l’ancien que représente le prince une leçon d’opportunisme politique – «Il faut que tout change pour que rien ne change» – n’est évidemment pas anodin. S’il prend la place de l’autre, visuellement, c’est aussi pour la prendre symboliquement et politiquement, sans pour autant remettre en question la prééminence des valeurs de celui qu’il prétend remplacer. Rien ne doit changer, in fine, sinon les apparences.
A regarder sur YouTube : Le Guépard (1963) - La Valse
Autre scène non moins emblématique, le bal. Salina danse une dernière valse avec Angelica (Claudia Cardinale), la fiancée de Tancrède. Le jeune homme, devant la grâce et l’élégance des danseurs, qui semblent si bien assortis, plonge dans un abîme de tristesse et de jalousie malade. Une fraction de seconde sur le visage de Delon, sur son regard mourant, suffit à dire le désespoir de celui qui sait qu’il a beau tout avoir, la jeunesse, la beauté, la richesse, l’avenir, l’amour, il n’aura jamais la souveraineté naturelle du Guépard, tout au plus partagera-t-il peut-être un jour sa mélancolie, en constatant les débris d’un monde dont il aura lui-même accompagné la chute. Transposée dix ans plus tard dans l’univers des barbouzes en cols blancs, la rivalité Delon-Lancaster (nouveau monde-ancien monde) se consommera dans la violence dans l’excellent Scorpio de Michael Winner. Sur le versant hexagonal, enfin, le besoin de se confronter à l’autre prend le visage, bienveillant ou non, du patriarche bourru (Gabin dans Deux hommes dans la ville et le Clan des Siciliens) ou s’incarne dans la rivalité amicale (entretenue par les médias) avec Jean-Paul Belmondo.

Les duels qui s’orchestrent dans la filmographie de Delon soulignent aussi le paradoxe de l’homme : être solaire et ombrageux, hypersensible et violent, acteur génial et star populaire, un genre de Clint Eastwood à la française, pouvant aussi bien incarner des êtres énigmatiques que des monolithes à la mâchoire serrée dans des nuées de polars plus ou moins réussis, réac assumé mais producteur exigeant soutenant des cinéastes de gauche (Alain Cavalier, Joseph Losey), et parfois même des films allant à l’encontre de ses propres idées – par exemple Deux hommes dans la ville (1973) de José Giovanni, réquisitoire contre la peine de mort, alors que Delon est pour.
Noirceur angélique et sensuelle
Jean-Luc Godard fera écho à cette dualité dans Nouvelle Vague. Le cinéaste, on le sait depuis le Mépris, a toujours su saisir comme personne l’essence des stars qu’il faisait tourner – Bardot, en 1963, était une icône mille fois photographiée, morcelée, atomisée sur l’autel de la célébrité ? Il la mettra littéralement en pièces (pieds, cuisses, fesses, seins), nue devant la glace, dans la fameuse scène du blason. De même, Godard accrochera sur le tard Delon à son tableau de chasse, dans un film qui sera comme le commentaire ironique de la «double polarité» de l’acteur, à ce moment précis de sa carrière qu’était la fin des années 80 et dont il allait pratiquement sonner le glas. En lui confiant le rôle des jumeaux Lennox, il capte un peu de ce que Delon était en train de devenir à cette époque : d’une part l’homme au bout du rouleau – «je fais pitié» est sa première réplique –, évoquant autant une carrière en légère perte de vitesse depuis quelques années que son goût masochiste pour les rôles d’hommes battus et, d’autre part, le battant reconverti en businessman carnassier, capitalisant sur sa notoriété dans l’industrie du luxe et les produits dérivés. Cela dit, Delon n’avait pas attendu Godard pour casser son image – déjà pathétique et alcoolique dans Notre Histoire (1984) de Bertrand Blier, ou zonard inquiétant dans l’étrange Attention, les enfants regardent (1978) de Serge Leroy… Godard lui aura juste donné le coup de grâce en scindant cette image en deux.
Car plonger dans ses propres abysses, livrer sa part maudite et monstrueuse, l’acteur n’avait cessé de le faire, mais sans jamais dissocier en lui l’ange et le démon, la braise et la glace, les larmes et l’impavide, l’éclat et les ténèbres. Comme si, chez lui, la beauté appelait le sacrifice, la présence irradiante l’effacement et le désir la perte. Visconti aura sans doute été le premier à déceler sa sauvage innocence et à la magnifier dans Rocco et ses frères (1960). Sa noirceur angélique et sensuelle, tracée à la mine de plomb, donne au film un air de requiem, de messe funèbre. Boxeur malgré lui, Rocco se sacrifie pour restaurer l’union de la famille atomisée par l’exil et pour préserver l’essence d’un monde qui a déjà disparu, ce Mezzogiorno pauvre et aimé des origines dont il ne peut que contempler la disparition en pleurant.
Ombre parmi les ombres, icône sacrifiée, Delon, tel un Christ éprouvé, n’est déjà plus de ce monde. En concédant sa part au tragique, l’acteur libérera, et de plus en plus, un ballet de fantômes mélancoliques, d’hommes traqués, de loups blessés et de psychés malades contaminées par le vide, auxquels Melville aura offert les plus beaux écrins. Delon sera l’acteur melvillien par excellence – à moins que ce soit Melville qui ait été delonien ? Sous la patte du cinéaste au Stetson, notamment dans le Samouraï (1967), le plus beau de leurs trois films communs, Delon, silhouette métonymique en imper et chapeau, se désincarne, animal à sang froid, mutique et glacial, tel un spectre languide marchant vers sa propre disparition. Et si Melville stylise la traque dans une palette atonale, beige et gris bleuté, c’est pour mieux faire crépiter la solitude sidérale de celui qui savait qu’avant même de mourir, il était déjà mort.
(1) «William Wilson» est le deuxième sketch, réalisé par Louis Malle, d’un film qui en compte trois, Histoires extraordinaires, tous inspirés de nouvelles d’Edgar Poe (les deux autres ayant été réalisés par Roger Vadim et Federico Fellini).
par Nathalie Dray dans le journal Libération.
Crédits : 1Dans «Plein soleil», de René Clément, en 1960. (Photo12 via AFP)/2 Dans «le Samouraï», de Jean-Pierre Melville, en 1967. (COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET COMMER/Collection ChristopheL via AFP)/3 Dans «Scorpio», de Michael Winner, en 1973. (SCIMITAR PRODUCTIONS/Collection ChristopheL via AFP)