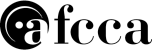A lire : La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des lumières à nos jours

La Parisienne se singularise par son «lien organique à la mode et au vêtement» et par sa façon d’être au monde. Identifiée par Rousseau dans la Nouvelle Héloïse, elle doit son existence au déplacement de la cour de Versailles à la capitale, effet de la Révolution.
La Parisienne se colore sans cesse d’une séduction distinguée ou vulgaire, d’une érotisation plurielle, «entre chic et chien», occupant ainsi un large spectre social.
Forte de ce constat, l’historienne Emmanuelle Retaillaud interroge un vaste corpus de sources pour saisir l’historicité de la Parisienne, dans un «va-et-vient entre le réel et l’imaginaire», une production essentiellement masculine. Ancrée dans l’histoire mouvante de la capitale, la Parisienne en est le miroir et irrigue aussi les mentalités provinciales. Ainsi elle devient un mythe incontournable, «moderne», «c’est-à-dire désacralisé, accessible, convoité par tous».(...)
Cette mise en valeur du féminin s’inscrit dans la stratégie bourgeoise des apparences, un jeu de dupes dénoncé dans la décennie 1840 par Delphine de Girardin : si cette Parisienne accroît la valeur de son sexe, elle lui a fait perdre de la puissance. Emmanuelle Retaillaud estime même que «la valorisation culturelle de la Parisienne a partie liée avec l’infériorisation politique et civique de la femme» ; elle participe de la «dégradation» de son insertion dans la sphère publique et de celle de son influence. Pour autant, la Parisienne fascine (...)
Le XXe siècle prouve la plasticité de ce mythe : de la garçonne des années 20 aux actrices de la Nouvelle Vague, en passant par la Parisienne new look des années 50, pour aboutir à la version d’Inès de La Fressange, la Parisienne s’adapte, en conservant ses fondamentaux, une part de son ambiguïté, expression sans doute d’une «inégalité des destins féminins ou masculins», mais peut-être aussi d’«une forme d’émancipation et d’agency».
La Parisienne, histoire d'un mythe du siècle des lumières à nos jours, d'Emmanuelle Retaillaud, Seuil, 422pp, 23€
Article complet de Yannick Ripa dans Libération du 20 février 2020