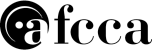A lire : "Les costumières seraient-elles devenues les nouveaux gourous du Style ?" le journal ELLE parle de nous !

Les costumières seraient-elles devenues les nouveaux gourous du Style ? D' "Emily in Paris" à "Euphoria", leurs looks pointus boulversent les codes et les envies. Rencontre avec les magiciennes de l'ombre.
Par Ilaria Casati, dans ELLE du 7 Avril 2022.
LE STYLE DES PERSONNAGES QU’ELLES HABILLENT SONT ADULÉS par des millions de personnes dans le monde. Pourtant, leurs noms restent peu connus du grand public. Anne Schotte (« Dix pour cent »), Marylin Fitoussi (« Emily in Paris »), Michelle Matland (« Succession »), Janty Yates (« House of Gucci »), Heidi Bivens (« Euphoria ») sont à l’origine des costumes de nos héroïnes préférées. Elles occupent désormais un rôle clé dans le monde de la mode. Pas besoin d’être une accro au shopping pour s’en rendre compte. Que ce soit les looks glamour de Sarah Jessica Parker dans « And Just Like That… », ceux chics et choc de Lily Collins dans « Emily in Paris », ou encore ceux Nineties de Zendaya dans «Euphoria », tout le monde se damne pour les copier.
Aux plateformes de mode Lyst et Pinterest de le confirmer : les recherches portant sur des séries battent tous les records. « C’est parce que le costume exprime de la personnalité, une signature, qu’il atteint le grand public, de plus en plus enclin à une consommation identitaire », analyse le sociologue Rémy Oudghiri. « L’avantage c’est que l’image reste et devient iconique », reconnaît le créateur de mode Rabih Kayrouz. Aux costumières d’imposer un style, un point de vue… et des best sellers. Que serait « Succession » sans ses ensembles radical chics Proenza Schouler, « Le Jeu de la dame » sans ses manteaux Stand Studio, « Squid Games » sans ses Vans Slip On blanches ?
À l’écran, ces must-have sont twistés par du vintage, des pièces de petits créateurs, parfois du luxe. Et qu’importe si, à la différence de ce que prescrivent les médias classiques, le résultat n’est pas du goût de tout le monde, l’important est de créer une signature. Une mode plus authentique. Marylin Fitoussi abonde dans ce sens : « Je ne veux surtout pas d’un style policé, formaté, et qui passe le crash test des magazines », déclare-t-elle. Certaines marques en ont des étoiles dans les yeux. « Je ne pouvais imaginer une telle mise en lumière. C’est la vision de Marylin Fitoussi et son goût hors pair qui font “Emily in Paris”. Elle est une leçon de style vivante », s’enthousiasme Adriana Abascal, fondatrice du label Skorpios, qui a vu sa notoriété exploser à l’étranger après que deux paires de bottes ont figuré au générique de la série. Quand les costumières mettent le monde de la mode à leurs bottes, le public en redemande. Pionnières, nouvelles icônes, prescriptrices de tendances, les louanges pleuvent.
Dans les années 1980, « Le Prince de Bel-Air », avec Will Smith, faisait déjà vendre des millions de baskets Air Jordan. Mais à l’époque, le bon costumier était présent par son absence. Or, comme l’a rappelé Patricia Field : « Le cinquième personnage de la série Sex & The City, c’est la mode, c’est moi ! ». Alors comment est-il possible que cette profession soit si longtemps passée sous les radars des médias et du public ?
Le manque de visibilité s’explique avant tout par le sexisme dans cette usine à rêves. En 2021, le CNC dénombrait une profession occupée à 89,8 % par des femmes. En comparaison, toujours selon le CNC, le métier de réalisateurs dans son ensemble compte 23,9 % de femmes.
« Pendant trop longtemps le métier a été sous-estimé, assimilé à tort à de simples séances de shopping. Encore aujourd’hui, nos noms sont souvent cantonnés au générique de fin et il existe de vraies disparités salariales. Par exemple, dans l’audiovisuel, les costumières gagnent jusqu’à 48 % de moins que les décorateurs », constate Alice Cambournac, présidente, cette année, de l’Association Française des Costumiers du Cinéma et de l’Audiovisuel. Heureusement des voix se font entendre, en France comme aux US, à l’instar du mouvement #NakedWithoutUs. La dernière (et pas n’importe laquelle): celle de l’actrice Julianne Moore qui a poussé un coup de gueule contre ce manque de parité.
Or, c’est peu dire que la conception des costumes implique une longue réflexion. « Tout commence à la lecture du scénario, continue l’experte. Il faut imaginer les différentes facettes de chaque personnage en se posant des questions rationnelles : d’où vient-il ? Qui est-il ? Sur quels critères choisit-il ses vêtements ? Se soucie- t-il de son apparence ? De combien de tenues à-t-il besoin ? Ensuite les costumes sont minutieusement constitués, piochés chez des loueurs, achetés dans les magasins, empruntés dans les showrooms de mode, et finalisés à l’aide de la seconde main. Résultat : ce sont des mètres de portants qui s’alignent ».
Quand il s’agit de s’attaquer à un personnage réel, ce n’est pas une mince affaire non plus. « Il faut l’étudier minutieusement pour ne pas le trahir. On n’a pas droit à l’erreur », explique Jacqueline Durran, qui a reproduit, entre autres, la garde-robe de Lady Diana dans le film « Spencer » de Pablo Larraín. « On ne réalise pas le travail de plusieurs semaines, voire mois, qu’exige notre profession. Chaque tournage est un marathon, puis on doit se réinventer pour la prochaine oeuvre », confie Alice Cambournac.
Car la costumière est cette personne en éveil permanent, qui s’inspire à tout coin de rue et peut rester des heures dans un endroit peu accueillant pour comprendre la façon dont s’habillent les gens de tel ou tel milieu. C’est celle aussi dont l’oeuvre peut être invisibilisée par un grand nom de la mode, quand celuici prête ou imagine un vêtement pour le tournage. « Auparavant, des personnalités comme Hubert de Givenchy, Yves Saint Laurent ou Calvin Klein ont accolé leurs noms au cinéma, en y voyant l’opportunité de prolonger leur business. Inévitablement, l’attention continue de se focaliser sur eux », déplore la légendaire Ruth E. Carter (« Malcom X », « Black Panther ») dans les colonnes du « New York Times ». Pire, la costumière peut être évincée d’un partenariat entre le studio et une marque à l’origine de produits dérivés qui ne reflèteront donc ni son style ni ses goûts. Récemment, Jenny Beavan en a fait la douloureuse expérience avec « Cruella ». Elle n’a pas eu son mot à dire sur la capsule lancée avec la marque américaine Rag & Bone. Des protestations légitimes qui cherchent de plus en plus à se faire entendre. Ainsi, pour changer le regard porté sur la profession, aux États-Unis, la UCLA School of Theater, Film and Television a inscrit le métier de costumière
dans la catégorie des savoir-faire créatifs du 7e art.
De fil en aiguille, les choses changent, portées par des films et des séries où la mode joue un rôle de premier plan. « Les costumières sortent enfin de l’ombre », se réjouissait Catherine Leterrier au Festival du Film francophone d’Angoulême l’été dernier. Et pendant que certaines intègrent des jurys de cinéma, d’autres ont vu récemment leur travail célébré lors de l’expo « CinéMode », organisée par la Cinémathèque française avec la complicité de Jean Paul Gaultier, et qui donnait à voir près d’un siècle de trésors. Ailleurs, des podcasts leur donnent la parole, comme « Profession costumières » lancé en 2019 par Céleste Durante. « Et puis ce métier a une touche magique qui mérite d’être traitée comme de l’art », renchérit-elle.
Et la profession ne compte pas s’arrêter là. Conscients de leur aura, Molly Rogers et Danny Santiago, costumiers de « And Just Like That » décryptent librement chacune des tenues de la série sur Instagram. D’autres jouent la carte de la proximité, en s’adonnant à des séances de questions-réponses avec leurs fans. Au risque de céder à la pression des marques ? Car naturellement, quand il s’agit de visibilité, les griffes ne sont jamais très loin pour faire un peu de marketing.
Alors que la deuxième saison d’« Emily in Paris » venait à peine d’être diffusée, le site saksfifthavenue.com proposait déjà une plateforme shopping où retrouver une sélection de pièces de la série. Idem sur netflix.com, qui commercialise depuis juin un ensemble de produits dérivés de ses shows cultes. Et on imagine qu’il nous sera bientôt possible de nous offrir directement sur notre télé la garde-robe de nos héros préférés.
Utopie futuriste ou prophétie crédible ? « Je n’exerce pas mon métier pour vendre des vêtements», se défend Meredith Markworth-Pollack, la madame costumes de « American Crime Story » ou « Dynasty », qui, au contraire, mise sur la seconde main pour freiner la surconsommation.
Pour éviter ambiguïtés et dérives, Marylin Fitoussi est claire depuis la signature de ses contrats : « Je ne fais pas de total looks identiques à ceux des podiums, car cela restreint ma créativité et réduit la possibilité de susciter la surprise », déclare-t-elle au Figaro.
Reste à voir qui, à l’avenir, aura le dernier mot : les studios de production, les marques ou les costumières ? Un face-à-face, dont l’épilogue se dénouera sur nos écrans. Rendez-vous au prochain épisode.
Photos : 1 article Elle, 2 Lily Collins dans Emily in Paris, 3 photo Instagram de Marilyn Fitoussi lors d'un essayage de Lily Collins, 4 photo Alice Cambournac (?)