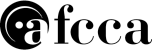A voir : "Azzedine Alaïa, Un couturier français" sur Arte

Nourri des éclairages d’un historien de la mode, de ses proches et de ses collaborateurs, qu'illustrent de très riches et émouvantes archives de ce créateur à la gouaille timide, disparu en novembre 2017, ce film retrace une carrière composée de deux périodes fastes et entrecoupée d’une traversée du désert : l’une en génial créateur des années 1980, l’autre en maître absolu de la couture après 2000.
Réalisation Olivier Nicklaus (2021)
Jusqu'au 26 Mars 2022 sur arte.tv
Et aussi , l'article du journal Libération du 26 et 27 Février 2022 par Marie Ottavi dans un entretien avec le réalisateur :
Les premières images du documentaire d’Olivier Nicklaus montrent Azzedine Alaïa triomphant, porté par ses mannequins qui l’acclament en scandant : «Azzedine ! Azzedine ! Azzedine !» Le couturier, mort prématurément en 2017, a été choyé, autant par ses modèles que ses clientes, et une foule de journalistes, américaines en premier lieu. Alaïa, petit homme (il mesurait 1m58) chaleureux et orgueilleux, n’en a toujours fait qu’à sa tête, défiant le système de la mode dans ce qu’il a de plus commercial – en défilant quand bon lui semblait ou en n’achetant pas de pages de publicité dans la presse –, jusqu’à frôler la banqueroute. Sauvée par Prada au début des années 2000, rachetée enfin par le groupe suisse Richemont, sa maison est toujours sur pied en 2022. Alaïa, lui, reste l’un des grands couturiers du XXe siècle, fin connaisseur du corps des femmes qu’il savait comme personne vêtir, embellir, servir.
Ils sont nombreux à avoir tenté de le faire parler de son vivant. Il a soigneusement refusé chaque micro tendu. Cinq ans après son décès, Olivier Nicklaus revient, dans un documentaire diffusé ce vendredi soir sur Arte, sur le parcours éclairé, parfois tortueux, de ce grand couturier parti de rien et pris tout au long de sa vie sous l’aile des femmes. Le réalisateur montre aussi savamment à quoi ressemblait le style Alaïa, près du corps, animal, dévorant, qui a laissé une empreinte forte sur la mode. Il évoque pour Libération la trajectoire du créateur et son caractère bien trempé.
- "Aviez-vous tenté de convaincre Azzedine Alaïa de vous raconter son parcours avant sa mort ?"
On a tous essayé, même Farida Khelfa [modèle et amie du couturier, ndlr]. Depuis les années 90, il envoyait valser toutes les demandes. Contrairement à ce qu’on peut imaginer, il était assez coquet, il ne voulait pas qu’on le filme vieux. Et il était assez protecteur de ses secrets de fabrication, il n’avait pas forcément envie de les dévoiler. Il n’était globalement pas à l’aise avec la caméra, on le voit dans les archives des années 80, quand il a été le plus filmé.
Après sa mort, j’ai rencontré Olivier Saillard, le directeur de la Fondation Alaïa, et Carla Sozzani, l’amie historique [et présidente de la fondation, ndlr], qui lui avait promis de faire vivre sa mémoire et celle de sa collection de vêtements, composée de 20 000 pièces, et de design. Azzedine Alaïa faisait plein de choses et il voulait que ça se sache. J’ai également rencontré le peintre Christoph von Weyhe, son compagnon pendant soixante ans.
- "Dans ce documentaire, que vouliez-vous montrer ?"
D’abord un parcours de Maghrébin qui a eu une réussite folle dans le monde de la mode. J’y tenais, surtout dans le contexte actuel avec la montée de Zemmour. Je voulais raconter sa réussite et son apport à la culture française. Son esthétique aussi. Très vite, j’ai acquis l’idée de ne pas écrire de commentaire pour ce documentaire, pour qu’Azzedine Alaïa raconte, en mettant sa voix en avant. Pour moi, c’est un sorcier qui avait une grande connaissance de la nature humaine. Il sent très bien les gens avec qui il va pouvoir faire quelque chose. Il nourrit des interrelations très fortes avec certaines personnes, mais il n’est pas forcément celui qui a lu tout Proust à 15 ans, comme Yves Saint Laurent, par exemple.
- "On découvre que les femmes l’ont toujours soutenu."
Son parcours est dingue, car il naît fils d’agriculteurs, dans la campagne tunisienne, puis part vivre chez sa grand-mère à Tunis. Là, une incessante chaîne de rencontres de femmes va se révéler déterminante. La première étant madame Pineau, la sage-femme française qui l’a accouché et veillera sur son éducation. Ils feuillettent ensemble le magazine Vogue et les catalogues de la Redoute. Elle sent qu’il a un œil et le pousse à entrer aux Beaux-Arts. On a souvent dit qu’il sculptait avec ces vêtements et il a vraiment pensé en sculpteur. D’ailleurs, il critiquait beaucoup les créateurs qui dessinaient, il disait que c’était de la 2D et que, eux, déléguaient aux premières d’atelier, alors que lui avait l’orgueil de dire qu’il savait faire un vêtement, de A à Z.
- "Il a gagné la confiance des femmes très jeunes ?"
Madame Pineau a changé son destin, mais avant elle, il y a eu la grand-mère, une femme très libre, loin de l’idée qu’on se fait aujourd’hui des femmes dans le Maghreb présentées comme soumises. Il disait que c’était une forte tête. Son rapport au corps des femmes, sa proximité avec lui, sans pudeur, lui vient de sa grand-mère. Il a découvert le corps des femmes au hammam enfant. C’est l’une des clefs pour comprendre Alaïa : il a toujours été près du corps des femmes, que ce soit des filles sublimes, comme Christy Turlington, Stephanie Seymour, Naomi Campbell, des stars de la pop culture comme Kim Kardashian et Lady Gaga, des comtesses dans les années 50 qui avaient des corps pas forcément aux normes. Il a gagné leur confiance, en les faisant rire, en les rassurant beaucoup, en leur disant qu’il allait gommer certains défauts par ces vêtements.
- "Les top models étaient prêtes à défiler pour lui quasi gratuitement ?"
Oui, elle défilait pour le tarif minimum. Il installait quelque chose de très familial avec les filles. Il a connu Naomi à 16 ans. Elle avait perdu sa valise, il avait appelé sa mère en lui disant «Ne vous inquiétez pas, je m’occupe d’elle». Il l’a logée, nourrie, blanchie. Elle ne l’a pas oublié. Tout en étant orgueilleux, parfois tyrannique, il introduisait aussi dans les mœurs de la mode – qui peuvent être violentes dans les grandes maisons – quelque chose de très familial et simple : «Est-ce que t’a mangé ?» ou «t’as un endroit où dormir ?» Ça, c’est la partie attachante d’Alaïa.
- "Il n’a passé que cinq jours chez Dior en 1956."
Son arrivée est concomitante à la guerre d’Algérie. Il a eu un problème de papiers, mais qu’il soit maghrébin n’est sûrement pas étranger au fait qu’il ne soit pas resté chez Dior. Même sans papier, s’ils avaient voulu qu’il reste, ils auraient trouvé un moyen pour qu’il obtienne ses papiers. Il est alors à la fois très protégé par la comtesse de Blégiers, Louise de Vilmorin, entre autres, qui facilitent sa présence en France, et en même temps il reste un Maghrébin. Tant mieux d’une certaine manière qu’il ne soit pas resté chez Dior, car c’est là qu’il commence à être couturier en chambre, à habiller toutes ces femmes. C’est son école. Il a fait un chemin plus singulier, à part.
Ensuite, il a travaillé pour Guy Laroche et le chausseur Charles Jourdan qui lui a commandé une collection de vêtements en cuir, près du corps. Ils ont trouvé ça trop érotique et ils ne lui ont pas pris la collection. Certaines rédactrices de mode de l’époque ont été photographiées dans ces robes par Bill Cunningham. Quand les gens du grand magasin Barneys de New York ont vu les photos dans WWD (Women’s Wear Daily), ils lui ont passé commande. Le succès a commencé aux Etats-Unis, avant la France.
- "Contrairement à d’autres, il n’était pas obsédé à ses débuts par le fait d’avoir son nom sur l’étiquette."
Il a d’abord fait plein de choses pour les autres, la toile de la robe Mondrian pour Saint Laurent par exemple. Il était perçu dans Paris comme quelqu’un d’exceptionnel, qui savait fabriquer des vêtements. Il restait dans l’ombre. Quand il a lancé sa maison, le moment était venu. Il a eu le soutien de Thierry Mugler qui l’a aidé à faire le casting du défilé. Alaïa ne savait pas comment ça marchait. Et puis, il y a eu la grande explosion des années 80. Plus tard, on lui a proposé des maisons, notamment Christian Dior quand Gianfranco Ferré est parti. Il a refusé. D’autres auraient accepté en disant «c’est ma revanche», mais lui était déjà ailleurs. Il avait envie de faire vivre sa propre maison à sa guise. Même quand ses affaires allaient moins bien, il a continué dans son coin. Il n’essayait pas d’avoir toujours plus, mais de faire exactement les vêtements qu’il voulait.
- "Azzedine Alaïa a failli tout perdre dans les années 90 en se mettant en retrait."
Alaïa préférait ne rien montrer de ce qu’il créait tant qu’il n’était pas certain que c’était bien. D’un côté, c’est beau et respectable, surtout si on voit le créateur de mode comme un artiste - les jeunes aujourd’hui dans la mode sont d’ailleurs très sensibles à cette façon de faire en franc-tireur – mais en même temps, c’était un grand risque. Si on ne livre pas les grands magasins à temps ou qu’on défile quand les journalistes étrangers sont rentrés chez eux, ça a des conséquences économiques dans une industrie comme la mode. Il a failli perdre la rue de Moussy. C’est là qu’il s’est associé avec Prada, puis avec le groupe Richemont [en 2007, ndlr]. D'un côté, c'est beau et respectable (les jeunes aujourd'hui dans la mode sont très sensibles à cette façon de faire en franc-tireur), mais en même temps, c'était un grand risque.
Photo : le couturier Azzedine Alaïa avec la mannequin Farida Khelfa. (Suzanne Rault Balet/Sygma via Getty Images)