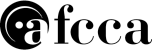A lire : Mostra Venise vedi vici
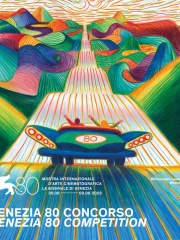
Par Laura Tuillier, envoyée spéciale à Venise du journal Libération du 6 septembre 2023
Farce à la truelle du côté de Polanski, fracture du nerf optique chez Korine, triangle de biopics luxueux… Pendant le festival vénitien, le ravissement d’un film pas comme les autres s’est longtemps fait attendre, avant que ne survienne le beau long métrage de Hamaguchi.
Comme Léa Seydoux (absente du tapis rouge en soutien à la grève des scénaristes et acteurs outre-Atlantique), qui joue une femme obsédée par la survenue d’un événement tapi dans l’ombre dans la Bête de Bertrand Bonello (en compétition), le festivalier vénitien est à l’affût. Ce qu’il cherche, de 8 heures à minuit, c’est à l’apercevoir. Les yeux rougis, la gorge prise (trop de clim en salle Perla), le cœur battant, on cherche à le voir, on croit le distinguer, on se demande s’il existe encore : le bon, le super film, celui qui nous ravit du début à la fin. Peut-être pas un chef-d’œuvre mais, enfin, une œuvre qui redonne foi dans les images, la preuve qu’elles bougent bien 24 fois par seconde, que le grand écran y est encore pour quelque chose. Et, disons-le, la bête n’a pas été facile à dénicher ces jours-ci sur le Lido.
Déblayons le terrain et commençons par le pire, présenté hors compétition en l’absence du principal intéressé : The Palace de Roman Polanski, sélectionné et défendu par Alberto Barbera, dénoncé par le collectif «Tapis rouge Colère noire» qui tapissait samedi soir les murs de Venise de slogans vénères tels que «Mostra 80 ans de retard» ou «Vergogna» («la honte»).

Avec Evil Does Not Exist, Ryusuke Hamaguchi signe le grand film de la compétition. - Photo NEOPA
Deux hypothèses se dégagent au sortir de cette infecte purge : soit le cinéaste ricane bien depuis son lugubre chalet de Gstaad, d’avoir réussi, littéralement, à infiltrer une merde à Venise (le film est obsédé par les excréments du chihuahua de Fanny Ardant) ; soit Polanski, au bord de la sénilité, régurgite les rebuts depuis longtemps contenus dans son cinéma (cruauté facile, gags de petit vicelard) sous une forme totalement ridicule. Allez savoir pourquoi - les temps étaient-ils meilleurs ? -, The Palace se situe à la veille de l’an 2000, dans un hôtel helvète de luxe. Avec un art de la satire qui fait de Ruben Ostlund le Michel-Ange de notre siècle, Polanski (aidé dans cette tâche par Skolimowski au scénario, tristesse et incompréhension) orchestre à la truelle un pitoyable bal des têtes, composés d’une brochette d’acteurs grimaçants plus ou moins botoxés, censés nous faire bien rire à leurs dépens et qui nous font monter les larmes aux yeux de dépit. Hagards, ils errent dans les couloirs de cet hôtel de carton-pâte comme dans un purgatoire sans limite, effectivement zombifiés par un bug de l’an 2000 qui s’appelle peut-être #MeToo. Mais ici et pour cette fois, ce n’est ni l’homme ni l’artiste mais bien le cinéma qui perd la partie.
Hoquet numérique
Hasard des programmes, c’est dans la même soirée que Harmony Korine procédait à un sabbat autour de la carcasse fumante du cinéma, en séance de minuit et en 1 h 20, avec rage et amour. De cette éprouvante cérémonie expérimentale, entièrement filmée à la caméra thermique et ambiancée par AraabMuzik (entre hip-hop, techno et trance, le sampler de Rhode Island fait figure de génie de la scène electro actuelle), beaucoup sont partis avant la fin, les tympans en charpie et le nerf optique en PLS. Mais que pouvait-on attendre d’autre du chenapan de Nashville, qui après la consécration Spring Breakers, il y a déjà plus de dix ans, avait prévenu qu’il voulait réaliser avec Aggro Dr1ft«ce qui n’est plus un film, ce qui vient après les films».
Dans ce trip multicolore ultra-agressif, il est question d’un tueur floridien - revenant du personnage de James Franco dans Spring Breakers, mais réduit à une pure mécanique - qui s’occupe de débarrasser Miami d’une figure de diable grotesque, digne d’un jeu vidéo un peu mal foutu, comme un hoquet numérique, le revers de nos fictions bien peignées. Dans Aggro Dr1ft, Korine invente des images si cauchemardesques qu’il semble en même temps souhaiter, dans un élan sentimental désespéré, qu’elles cessent d’exister. Et pourtant, nous sommes fascinés comme lui («mesmerized» est le beau mot anglais employé par le héros), incapables de détacher les yeux de ce contemporain en fusion, dégoulinant d’un magma acide et pop qui, paradoxalement, nous lave le regard. Il se trouve que Korine fait une apparition - tapi dans le coin d’un écran, comme un clin d’œil sous forme d’un extrait de Trash Humpers - dans la Bête, où il est également question de signes contemporains, de quête obsessionnelle et de flux numériques.
Adaptant la Bête dans la jungle de Henry James, Bonello bâtit une grande cathédrale à la gloire des larmes de Léa Seydoux, qui traverse les époques - de la crue parisienne de 1910 à un futur proche où l’on se nettoie des émotions pour vivre en heureuses machines - à la recherche d’un traumatisme enfoui, un événement plus grand qu’elle qui donnera un sens à son errance métaphysique. Piochant chez Lynch (une dernière scène dans une red room parisienne) et chez Cronenberg (toute la partie à Los Angeles, dans une immense baraque de verre), Bonello donne l’impression de courir après la modernité, au four et au moulin d’un film inutilement compliqué, pour trouver la façon juste de parler de notre époque. Tout a l’air de faire sens, mais rien n’est réellement nécessaire. Tout est parfait (la direction artistique, la musique, pas de fashion faux pas), mais la cérémonie manque de panache, d’un peu de désordre ou de panique.
Autre bête, autre apparition en demi-teinte sortie des limbes de notre temps, celle de The Killer, le film de David Fincher produit par Netflix. Michael Fassbender, expert de ce genre de performance désaffectée, y incarne un tueur à gages sans conscience, un maître yogi de la mise à mort efficace, un professionnel de cette ère numérique et fluide où tout se résout d’un clic ou d’un bip discrets. C’est ce qu’il nous explique à longueur de voix off mais, manque de pot pour lui, il commence à foirer ses contrats et nous ferait presque croire que Fincher réalise sa première comédie, ayant pris conscience du potentiel burlesque des assassins trop sérieux et de leurs gadgets de James Bond. Las, ce squelette de thriller n’est pas assez drôle pour se mettre à danser et pas assez intelligent pour nous effrayer.
Epicurien ultracharismatique
Les autres grosses bêtes de festival, ce sont les biopics. Ferrari de Michael Mann (dont nous avons déjà parlé), Maestro de Bradley Cooper (devant et derrière la caméra) et Priscilla de Sofia Coppola formaient le triangle 2023, tous trois luxueux films d’époque situés dans les sixties glamours.
Maestro, c’est Leonard Bernstein sa vie son œuvre, de ses débuts à l’Orchestre philharmonique de New York - un simple remplacement improvisé à 25 ans qui le propulse durablement sous les feux de la rampe - jusqu’à ses vieux jours où, cheveux blanchis et dignes rides, il regrette sa femme bien aimée. Souvenons du premier film de Bradley Cooper, A Star Is Born, remake du chef-d’œuvre de William Wellman, qui savait tirer le meilleur parti de son couple de midinettes pour proposer un mélo contemporain propre à nous arracher des larmes. A nouveau, il semble que Bradley Cooper se sente plus à l’aise dans la chronique familiale que dans l’épopée bigger than life, et c’est quelque part tant mieux : négligeant les passages obligés des traditionnelles hagiographies hollywoodiennes, il prend le parti de laisser dans l’ombre de grands pans de la vie du chef d’orchestre et compositeur star (West Side Story, la levée de fonds pour le Black Panther Party…) et se concentre sur la vie sentimentale de Bernstein, son mariage et sa bisexualité. Parfaitement émouvant dans l’habit de l’épicurien ultracharismatique qui en vient à souffrir de «trop aimer», Bradley Cooper sait comment tailler des scènes pour les acteurs - lui-même avant tout, et Carey Mulligan en épouse dévouée -, c’est-à-dire en longs plans séquences immobiles, justement en ne taillant rien, en proposant de la durée. Le meilleur de Maestro est construit selon ce principe de plan unique, de la rencontre -en format 4/3 noir et blanc, très chic, un peu toc - dans le secret d’une boum échevelée à la dispute dans le lointain d’un plan large qui joue sur les échelles - un couple se déchire en figurine, enseveli dans le fracas d’un carnaval. Mais Maestro est un biopic quand même, et c’est par le métier sur lequel il est censé se pencher qu’il pèche : le rapport à la musique de Bernstein est réduit à une opposition inféconde entre son activité de chef d’orchestre et sa vocation de compositeur, et les rares séquences de direction, toutes entières centrées sur le maître, frôlent la caricature d’Actors studio. Pour le coup, il nous manque le contrechamp, c’est-à-dire l’orchestre, c’est-à-dire la multitude qui vient enrichir le point de vue, contrecarrer le démiurge.
Avec Priscilla, Sofia Coppola offre assez modestement - et ce malgré les parterres de robes Chanel qui jonchent chaque séquence - un portrait de Priscilla Presley, la très jeune et malheureuse épouse d’Elvis. Estampillé biographie officielle (la veuve du chanteur est productrice exécutive), le film ne cherche pourtant pas à faire de Priscilla un modèle d’empowerment face au monstre Presley, ou l’héroïne qu’elle n’était pas. Au contraire, la réalisatrice a la sagesse de s’accorder à l’époque qu’elle filme, de regarder droit dans les yeux les jeunes filles telles qu’elles étaient alors : sages et amourachées des rockers, obéissantes jusqu’au malheur, souples comme des poupées de chiffon. La constance avec laquelle elle filme l’absence de libre arbitre de Priscilla est à vrai dire assez fascinante : son actrice, Cailee Spaeny, est comme prise d’un étourdissement qui durera tout le film, quand on lui annonce qu’Elvis Presley aimerait bien l’inviter à sa fête. Dès lors, prise dans l’image vaporeuse et sombre de Coppola, elle se mettra à suivre sa célébrité de petit ami dans un labyrinthe obscur comme un tombeau où celui-ci voudra la perdre. Histoire d’amour entre une mineure (elle a 15 ans au début du film) et un pygmalion dépressif, Priscilla ne fait pas semblant d’ignorer les écueils d’une telle entreprise. Le sexe, par exemple : c’est la jeune fille qui réclame à Elvis de pouvoir faire l’amour avec lui mais avec candeur, tandis qu’il se dérobe sans cesse, mais avec vice.
Sensoriel et politique
Et puis, in extremis avant notre départ, elle était là, la bête, et elle nous regardait littéralement dans les yeux : il ne faut pas trop en dire, parce que le film se termine sur un épais mystère qu’on ne saurait dévoiler, mais l’on peut assurer que Ryusuke Hamaguchi (Drive my car) signe avec Evil Does Not Exist le grand film de la compétition, le film sensoriel et politique qui nous avait manqué.
Filmant une petite ville japonaise rurale enclose dans la neige d’une fin d’hiver, il construit, avec une patience hypnotisante, la géographie d’un écosystème fragile et merveilleux. Lorsque deux communicants arrivent depuis la ville pour vendre aux habitants un absurde projet de «glamping» (glamour + camping), le film embraye sur le face-à-face entre villageois et citadins, les premiers soupçonnant un coup de Trafalgar du capitalisme immobilier, les seconds arguant qu’ils ne sont pas décisionnaires. L’intelligence d’Hamaguchi est de ne pas se contenter du point de vue des habitants, mais d’aller voir du côté de la firme, de ce qui se trame lors des rendez-vous pros et des longs trajets de débrief. Et bien sûr, alors, on s’attache au diable, et on se met à douter. Comme le héros du film, on l’invite à notre table et on le laisse couper du bois. Il y a presque du Giono dans la dernière demi-heure d’Evil Does Not Exist, une façon de transformer la promenade dans la forêt en incroyable voyage allégorique, où les figures les plus ambiguës finissent par apparaître dans la beauté blanche de quelques raccords équivoques. Le sens est suspendu, la bête peut bondir.